Le milieu scolaire est un environnement déterminant pour le développement des enfants et des adolescents. Pour les profils atypiques, cet environnement peut représenter à la fois une source de stimulation et de défis uniques. Les individus atypiques, caractérisés par leur pensée divergente, leur créativité et leur sensibilité accrue, apportent une richesse au sein des établissements scolaires, mais nécessitent également des approches pédagogiques adaptées pour s'épanouir pleinement. Cet article explore les défis et les forces des profils atypiques dans le milieu scolaire, ainsi que les stratégies pour favoriser leur réussite académique.
-- SOMMAIRE --
-
Les défis et les forces des profils atypiques dans le milieu scolaire
- Les défis
-
- Surcharges cognitives
- Manque de reconnaissance
- Incompréhension des enseignants et des camarades
- Décrochage scolaire
- Manque d'estime de soi
- Les forces
-
- Pensée inversée
- Pensée créative
- Persévérance face à l'échec
- Capacité de mémorisation
-
Le rôle du corps enseignant et des parents
- Pour le corps enseignant
- Pour les parents
-
Le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement
- Pourquoi les profils atypiques sont-ils plus vulnérable ?
- Mesures de prévention et d'actions
Les défis et les forces des profils atypiques dans le milieu scolaire
Les défis
Les enfants et les adolescents aux profils neuro-atypiques (HP, TDAH, etc.) ont un cerveau qui fonctionne différemment de leurs camarades. Ce décalage peut les mettre à l'écart. Voici les défis que ces enfants et adolescents atypiques ont à surmonter :
- La surcharge cognitive,
- le manque de reconnaissance de leurs besoins spécifiques,
- l'incompréhension de la part des enseignants et/ou des camarades,
- le risque de décrochage scolaire,
- le manque d'estime de soi.
La surcharge cognitive : l'école fait apprendre plusieurs matières à la fois. Le cerveau sature pour tous les élèves. Peu de matières sont vues en profondeurs. Or, les profils atypiques s'intéressent profondément à un sujet à la fois et le cerveau ne peut "encaisser" d'autres informations. De plus, la multitude de consignes différentes d'un professeur à un autre accentue cette surcharge cognitive.
Le manque de reconnaissance de leurs besoins : malgré la volonté de reconnaissance de l'handicap non physique des MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), la lenteur administrative et le manque de formation et de personnel, est un "handicap" pour sortir de l'exclusion, ces élèves neurodivergents. Ce qui peut causer un mal-être lors des examens éducatifs, par exemple. Les classes spécialisées sont encore peu nombreuses pour faire que ces jeunes atypiques s'épanouissent dans leurs études.
L'incompréhension de la part des enseignants et des camarades : il est encore compliqué, dans la mémoire collective, de reconnaître qu'un handicap n'est pas toujours physique. Les mauvaises réponses au tableau, les fautes sur les copies, les mauvaises notes et appréciations peuvent être des sujets d'acharnement de la part des professeurs, sans doute dans le but de les faire évoluer. Mais cette maladresse peut s'amplifier par les camarades en les transformant en moquerie et par conséquent, en exclusion.
Le risque de décrochage scolaire : cette incompréhension, cette exclusion ne motivent pas ces élèves exceptionnels. Leurs erreurs sont plus pointées du doigt que leurs efforts avec des encouragements. Ils n'en font alors plus ou s'ennuient parce qu'ils n'ont pas le même niveau que la classe. Ces profils se retrouvent bien souvent à emprunter la voie professionnelle pour continuer leur scolarité.
Le manque d'estime de soi : les erreurs pointées du doigt ou soulignées en rouge, les moqueries, le décalage scolaire, encore pointé du doigt, sont autant de causes pour manquer d'estime de soi. S'ajoute le fait qu'un élève atypique choisisse la voie professionnelle pour entendre ce qui n'a jamais été le cas : "L'apprentissage est une voie de garage !". Pour lui, cela veut dire qu'il est nul, incapable de faire des "études normales".
Les forces
Il est important de prendre en considération ces élèves atypiques, car ils sont tout simplement des pépites, notamment pour le travail collectif. N'oublions pas qu'ils ont un cerveau qui fonctionne différemment de "l'ordinaire". Voici les forces à considéré pour mieux les comprendre... Ou pas tout de suite :
- la pensée inversée,
- la pensée créative,
- la persévérance face à l'échec
- la capacité de mémorisation
- etc.
La pensée inversée : il n'y a rien de plus agaçant qu'un élève qui trouve un résultat sans suivre les étapes énoncées. "Tu vas trop vite", "Je ne vois pas tes opérations sur ta copie.". Pour certains élèves, ces étapes ne servent à rien puisqu'ils ont compris le processus. D'autres font des associations en suivant leur logique et perdent du temps à rendre les consignes "comme tout le monde".
La pensée créative : depuis toujours, sans le savoir, nous visualisons, nous créons, nous inventons. Nous sommes tous des boites à idées. Seulement, tout le monde n'a pas cette faculté innovatrice qui débloque instantanément des situations. Ces élèves-là sont des moteurs pour les travaux collectifs. Malheureusement, l'exclusion fait que ces cerveaux neurotypiques ne sont pas au service des équipes au sein de la scolarité.
La persévérance face à l'échec : ces jeunes profils atypiques sont déjà des perfectionnistes. S'ils n'ont pas compris ou n'ont pas réussi, ils ne veulent pas rester sur leurs échecs. C'est impensable pour eux ! Pourquoi ils réussissent dans certaines matières et pas dans d'autres ? Cela devient une obsession pour eux qui ne s'atténuera pas plus tard dans le monde du travail (ou de l'entrepreneuriat).
La capacité de mémorisation : faire plusieurs choses en même temps et avoir l'impression de ne pas être écouté, c'est déroutant pour l'enseignant. Demander par exemple, à un élève TDAH de s'arrêter à faire autre chose pour vous regarder dans les yeux et vous écouter. C'est peine perdue ! Mais si vous lui demandez de se souvenir du cours que vous avez dispensé à l'oral deux jours plus tard, il vous donnera des détails. C'est un exemple parmi d'autres, car il y a du mouvement. D'autres profils ayant un handicap invisible, n'auront pas besoin de bachoter leurs cours pour être reçu à leurs examens. Bien entendu, il y a des exceptions.
Le rôle du corps enseignant et des parents
Mon but dans ce chapitre, n'est pas de stigmatiser les adultes dans leurs positions, parce que chacun fait avec les moyens qu'il dispose et fait de son mieux. Voici quelques pistes de réflexion que je peux vous apporter étant moi-même atypique et ayant travaillé avec les jeunes dans les écoles, périscolaires et animation, dont certains avec des handicaps invisibles (ayant même refusé, par manque d'effectif...).
Pour le corps enseignant
Il est difficile de mettre en place un suivi personnalisé dans une classe de trente élève avec un programme chargé à suivre entièrement. Il est également difficile pour les élèves désireux d'apprendre, à suivre les consignes des enseignants qui ne font que réciter leurs cours avec le chaos dans la classe. Le burn-out s'installe des deux côtés et c'est le décrochage scolaire assuré.
Le moyen serait alors de s'imposer en tant qu'enseignant et d'innover dans la façon d'enseigner, même si ce n'est pas "académique". Parfois, passer par le jeu peut être bénéfique. Même les turbulents prendront un plaisir d'apprendre. Tout le monde sera pris en considération et l'écoute ne sera plus passif. Les TDAH qui n'aiment pas rester assis, seront ravis !
Pour les parents
Ce n'est pas parce que les professeurs décrivent un comportement atypique de vos enfants, qu'ils sont HPI, par exemple. Tout comme un comportement turbulent ne signifie pas que l'élève a le TDAH. Il existe des tests à passer auprès des professionnels (et non sur Internet) pour diagnostiquer l'atypisme ou non. Certains handicaps invisibles sont reconnus par les MDPH. Cela permet au corps enseignant de mettre en place une pédagogie différente (si possible) ou d'avoir un accompagnateur (AVS), par exemple.
La valorisation de vos enfants, dans ses devoirs, dans les tâches quotidiennes, et même dans les activités extrascolaires est importante. Cela les motive dans leurs efforts. Bien sûr, il est nécessaire de se mettre à la place des enseignants, d'être bienveillant envers eux, car ils font avec les moyens que l'Education Nationale leur fournit (outils, effectifs, programmes, etc.).
Le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement
Pourquoi les jeunes atypiques sont vulnérables ?
Les jeunes disent ce qu'ils pensent sans filtre, même si ce n'est pas la vérité. (Ils regardent qu'avec leurs vérités). Ils évoluent dans une société où le regard des autres et l'appartenance à un groupe leur semble important. Les neuroatypiques qui pensent autrement, deviennent vulnérables et donc "des proies" face à un groupe d'élève.
Leur maturité et la croyance des autres répercutés sur eux, font que leurs différences, leurs difficultés de communication ou encore leur hypersensibilité sont perçus comme des faiblesses. Ils s'isolent, ce qui favorise les "attaques" de plusieurs individus réunis pour un même objectifs : se sentir fort.
Les mesures de prévention et d'actions
Un groupe qui se réunit dans la cour et qui se "chamaille" ne joue pas forcément. Il y a lieu d'y prêter attention. Bien souvent, les adultes les séparent pour avoir la paix. Or, il est important d'écouter les uns et les autres pour avoir les bons réflexes. C'est-à-dire surveiller le groupe, pour savoir si votre intuition est la bonne et ensuite, le cas échéant, prévenir la hiérarchie et convoquer sans jugement.
Au sein de la famille, l'écoute est importante. Les jeunes peuvent se muer dans le silence. C'est alors qu'il est important d'observer le changement de comportement, par exemple. Dans cet article, mon intention n'est pas de juger, mais de vous donner des pistes, comme demandé de l'aide si vous vous sentez démunis. Les regrets dépasseront la honte, si vous ne le faites pas.
Le harcèlement ne s'arrête pas aux portails des écoles. Malheureusement aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des outils de défoulement. Est-ce que l'école et les familles sont responsables ? Difficile de le dire. Les réseaux sociaux sont interdits aux jeunes de moins de treize ans. Même avec un contrôle parental, les adolescents savent facilement contourner le contrôle. Aussi, il n'y a pas besoin que le harcelé soit sur les réseaux sociaux pour subir le cyberharcèlement.
Des plateformes de soutien en ligne existent pour être écouté et avoir des conseils professionnels :
- Pharos est une plateforme du gouvernement pour signaler des infractions sur le net, dont vous êtes victime.
- 30 18 est le numéro national d'écoute et de conseils pour les victimes de harcèlement et de cyberharcèlement.
Le milieu scolaire est un environnement que les jeunes profils atypiques n'affectionnent pas particulièrement, malgré leurs obsessions d'apprendre et de réussir. Leurs différences peuvent déranger dans la façon d'enseigner qui fait modifier la routine, et dans leurs personnalités qui les amènent à être distants. Une situation vulnérables et propices à des harcèlements et des cyberharcèlements. Fort heureusement, les outils sont plus nombreux que par le passé, mais la méchanceté des jeunes grandit...
N'hésitez pas à partager l'article sur Pinterest grâce à ces épingles
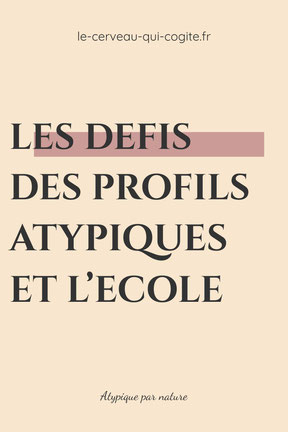

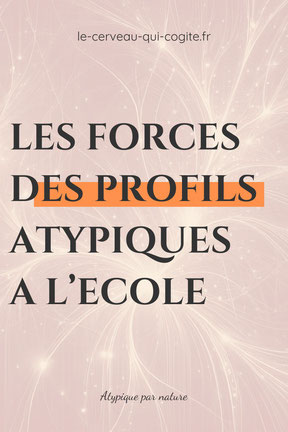

Écrire commentaire